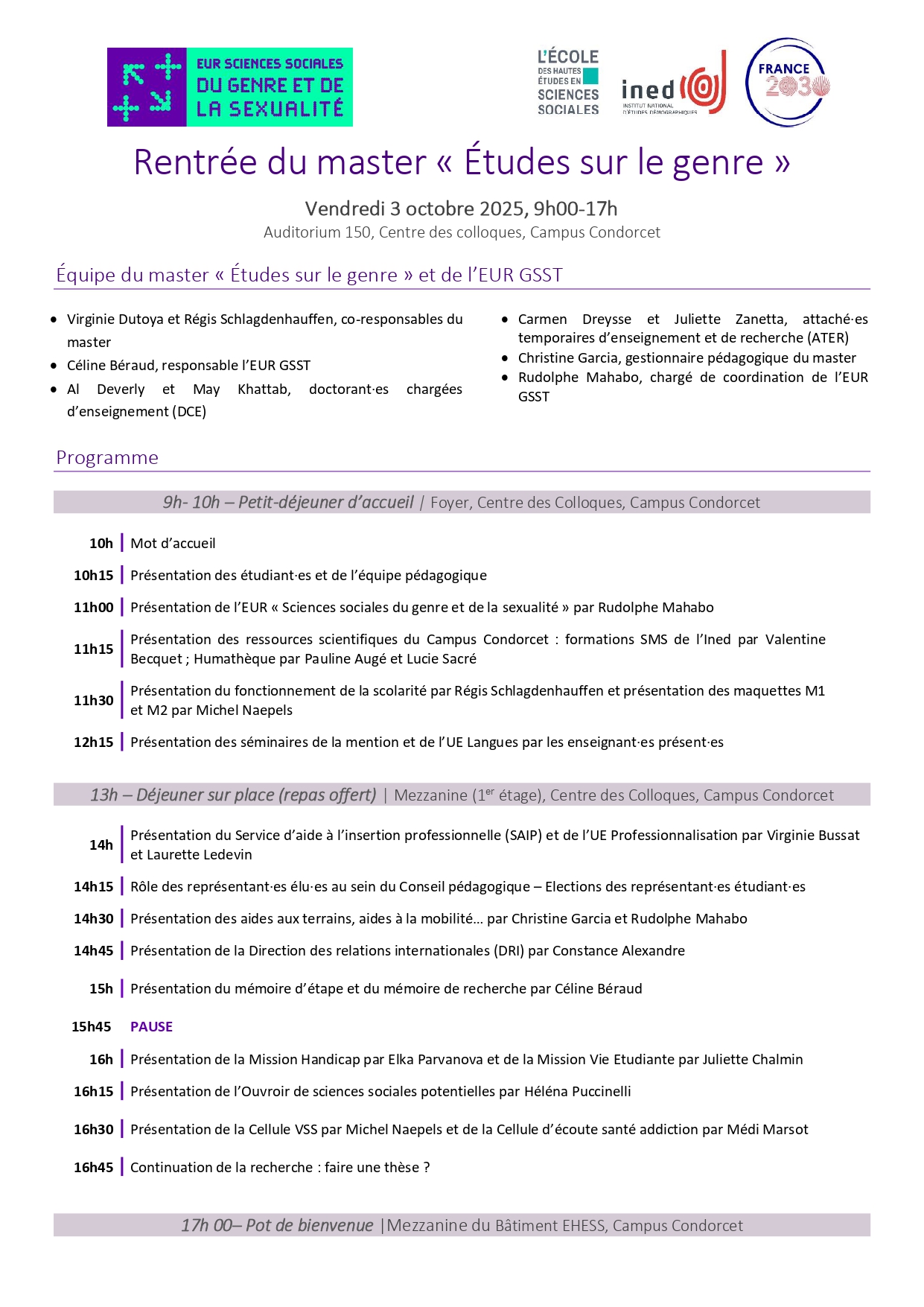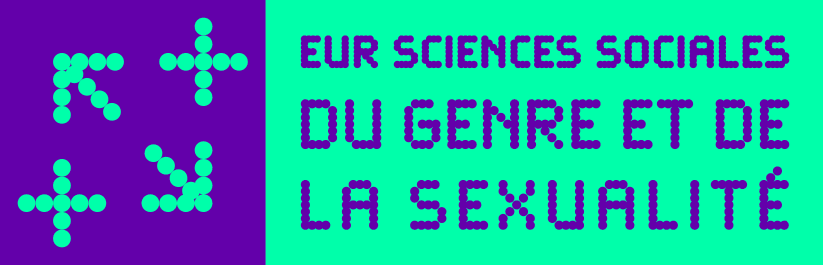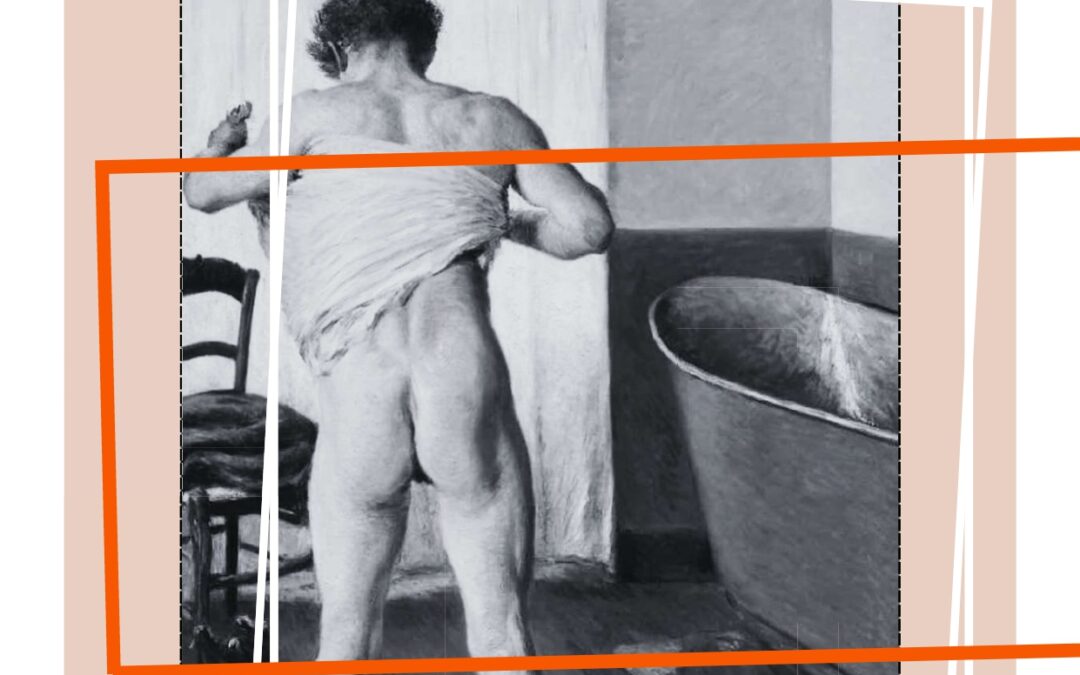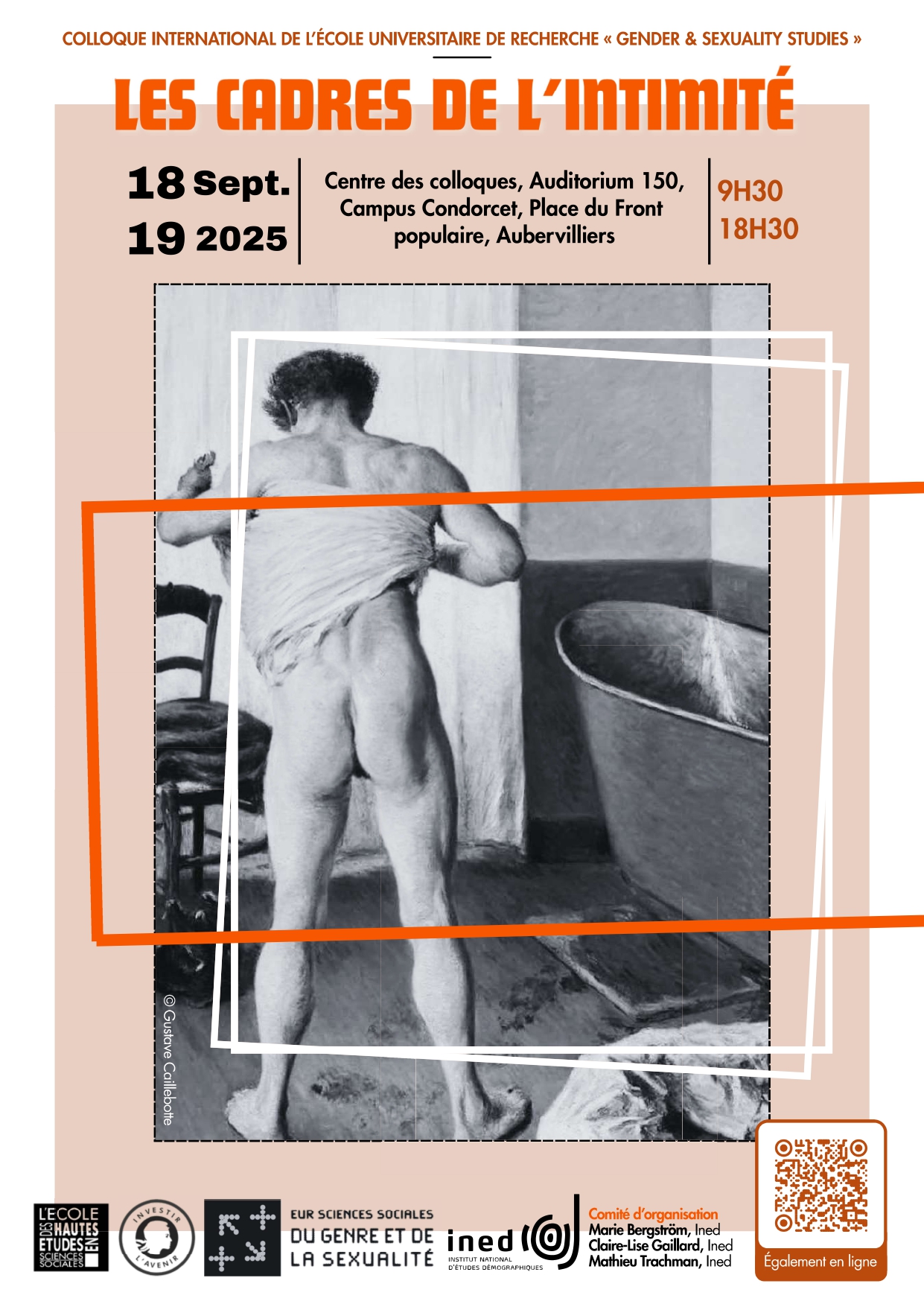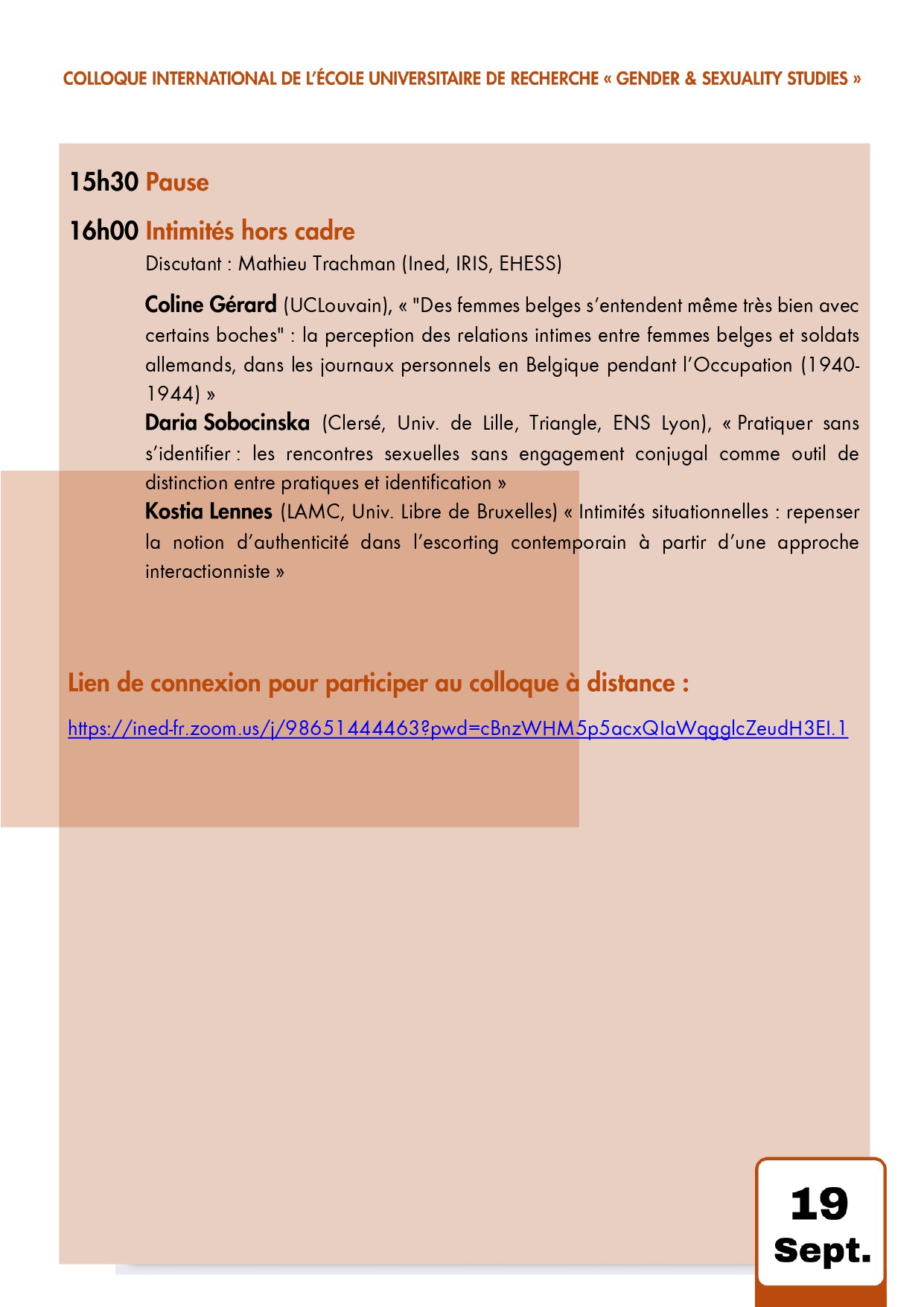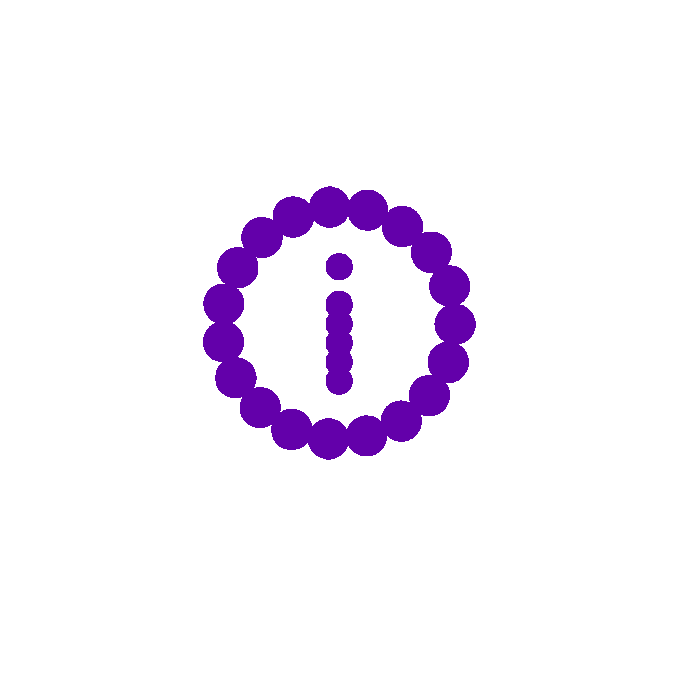L’Ecole Universitaire de Recherche Sciences sociales du genre et de la sexualité (EUR GSST) a lancé cette
année la première édition de l’ « Aide à l’achèvement de la thèse de l’EUR GSST ».
Cette aide d’un montant de 10 000 € par lauréat·e est destinée à permettre à des doctorant·es (affilié·es à l’EUR GSST, EHESS et Ined), qui ne bénéficient plus de financement de thèse, de terminer la rédaction de leur thèse dans les meilleures conditions.
Lauréat·es 2025 (par ordre alphabétique) :
Naïma BOURAS (EHESS, CéSor)
« Le genre du prêche : femmes, salafisme et reconfigurations de l’autorité religieuse en Égypte (1970-2016) » (dirigée par Stéphanie LATTE-ABDALLAH)
Agnès MENGOTTI (EHESS, Césah)
« Le suicide des femmes à Chennai, Inde : normes, affects et institutions » (dirigée par Stéphanie TAWA LAMA et Caterina GUENZI)
Maialen PAGIUSCO (Sciences Po Toulouse – Université Toulouse Capitole, LaSSP)
« La politisation ordinaire de l’homosexualité. Socialisations des jeunes lesbiennes et gays en contexte de reconnaissance sociale » (dirigée par Eric DARRAS et Wilfried RAULT)
Morgann PERNOT ALI (EHESS, Iris)
« Des générations en migrations. Du village yéménite à la ville, de la ville à Djibouti, généalogie du travail reproductif de la femme au foyer » (dirigée par Blandine DESTREMAU)
Lola ROLLAND (EHESS, LAS)
« Politique des sexes et intimité : genre, parenté et sexualité féminine dans l’archipel de Nosy Be (Nord-Ouest de Madagascar) » (dirigée par Julien BONHOMME et Laurent BERGER)
Caroline WEILL (EHESS, CERMA/Mondes Américains)
« Des haciendas à l’extractivisme sexué : échange économico-sexuel et colonialité au sud des Andes péruviennes » (dirigée par Anath ARIEL DE VIDAS)