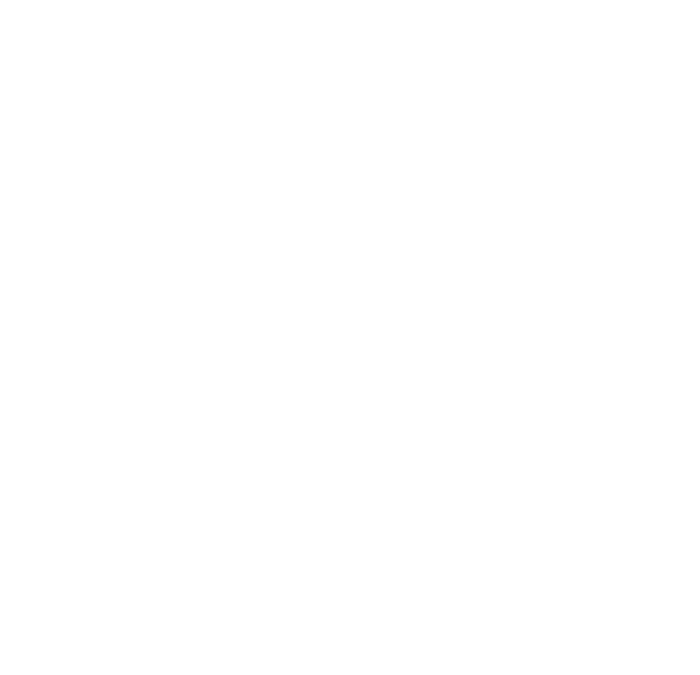
Master | Journée de rentrée 2023-2024
Mot de passe protégé
Pour voir ce poste protégé, tapez le mot de passe ci-dessous:
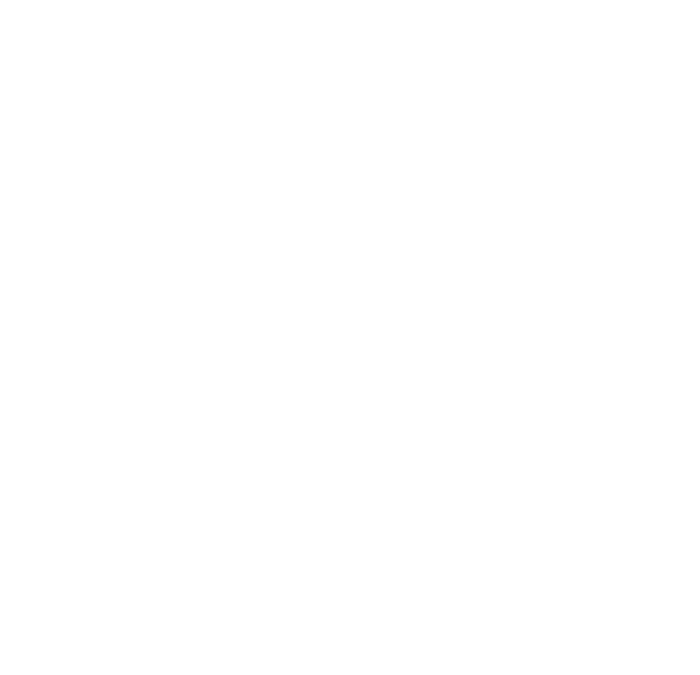
Pour voir ce poste protégé, tapez le mot de passe ci-dessous:
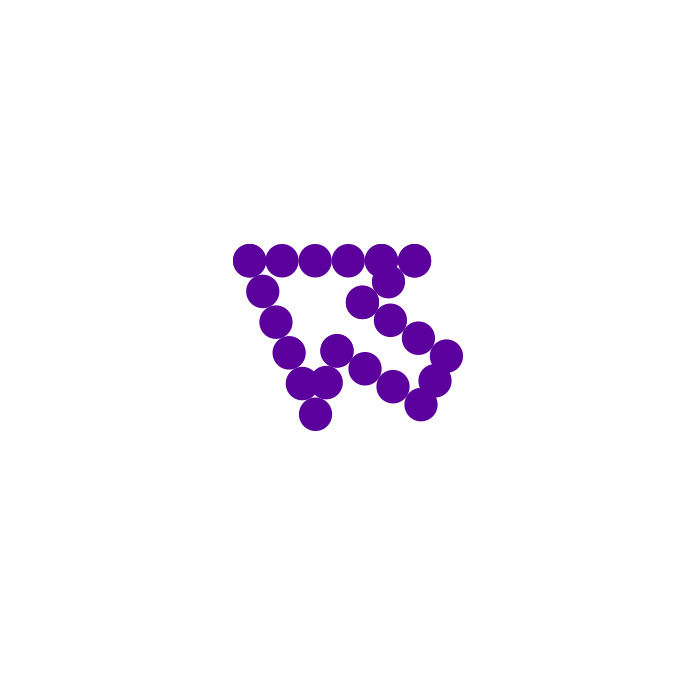
Les doctorant·es encadré·es par un·e directeur‧ice de thèse de l’EUR GSST dont les recherches portent principalement ou partiellement sur les questions de genre et de sexualité, mais n’étant pas inscrite au sein de la formation doctorale Sciences sociales et genre de l’EHESS, peuvent demander leur affiliation à l’EUR. Les demandes d’affiliation pour l’année 2024-2025 sont ouvertes jusqu’au 30 octobre 2024 via un formulaire en ligne.
Les doctorant·es affilié·es pourront participer à la rentrée des doctorant·es le 6 novembre 2024.
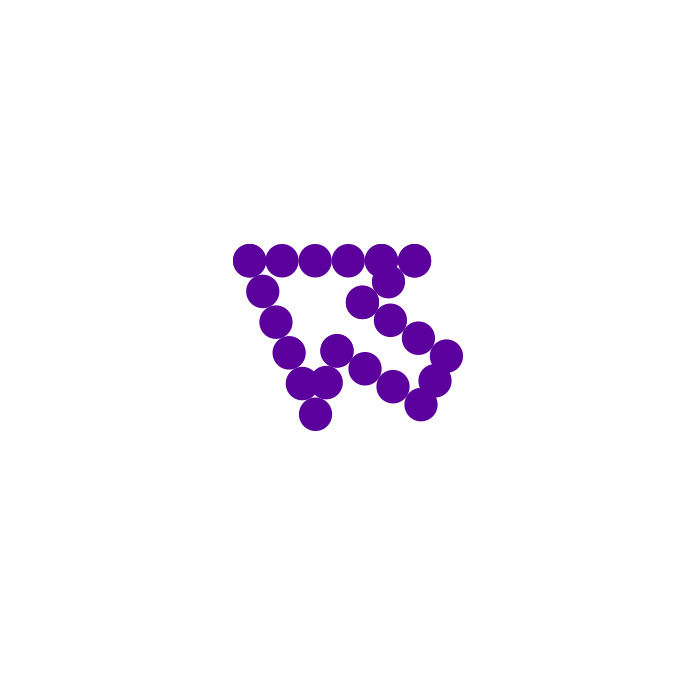
Dans le cadre des activités de formation déployées par l’École Universitaire de Recherche Sciences sociales du genre et de la sexualité (E U R GSST), portée par l’École des hautes études en sciences sociales (EHESS) et l’Institut national d’études démographiques (Ined), cet atelier doctoral propose de réfléchir aux pratiques de l’enquête dans le champ des études de genre et de sexualité. L’enquête empirique constitue le fil rouge, permettant d’embrasser les réflexions d’un champ et ses différentes déclinaisons disciplinaires par ses arts de faire méthodologiques. L’objectif de l’atelier est ainsi de proposer un espace de formation, de réflexivité et de partage de pratiques à et avec de jeunes chercheuses et chercheurs dont les travaux mobilisent le concept de genre.
Il s’agira de partir de l’enquête empirique, adossée à des archives, un terrain ethnographique et/ou des données statistiques, pour travailler avec les outils des sciences sociales du genre et de la sexualité. L’atelier repose sur une approche mixte qui puise dans des méthodes tant quantitatives que qualitatives pour analyser les phénomènes sociaux. Du fait de la transdisciplinarité des études de genre et de sexualité, nous souhaitons plus précisément promouvoir un décloisonnement entre différentes méthodologies – recherches en archives, entretiens, observations, enquêtes par questionnaire et autres sources quantitatives. Une des originalités de l’atelier doctoral réside notamment dans l’intérêt porté au croisement de l’approche statistique avec l’approche compréhensive et historique. Alors que les études de genre ont traditionnellement été fondées sur des méthodologies qualitatives, il s’agit ici de montrer comment l’enquête historique et ethnographique peuvent avec profit être “armée[s] par des statistiques”. L’objectif est de faire dialoguer des réflexions méthodologiques qui à l’origine se sont développées à partir de disciplines, de sources ou de méthodes d’enquête distinctes.
L’atelier se montrera particulièrement attentif aux perspectives intersectionnelles qui permettent de replacer plus largement les études de genre et de sexualité dans le champ des savoirs critiques. Aussi, toute une réflexion sera développée sur la façon dont les rapports sociaux de genre et sexualité s’imbriquent avec d’autres rapports de pouvoir et de différenciation socialement construits – tels que l’âge, la classe sociale ou la race – et de la gageure méthodologique qu’il y a à saisir finement cette imbrication et ses dynamiques. De même, il s’agira de réfléchir à la diversité des approches du genre. Marquées par une tradition d’engagement et une perspective féministe, les recherches menées en étude de genre n’en recouvrent pas moins une diversité de positionnements épistémologiques, comme ont pu, entre autres, le montrer les travaux portant sur les circulations internationales des études de genre et de sexualité, ou adoptant des approches transnationales, postcoloniales ou décoloniales. L’atelier sera l’occasion de réfléchir collectivement aux articulations possibles entre différentes épistémologies, et leurs implications pour l’enquête. Une attention particulière sera portée à la “positionnalité” de l’enquêteur ou de l’enquêtrice, à son rapport à son objet de recherche, aux personnes enquêtées ainsi qu’aux questions éthiques que pose la récolte de données sur le genre et la sexualité.
L’ensemble de ces réflexions sera développé à partir des recherches menées par les participantes et participants. L’atelier sera construit principalement autour de communications préparées par les participantes et participants sur leurs enquêtes empiriques en cours et les enjeux – notamment éthiques, méthodologiques ou épistémologiques – que soulèvent ces enquêtes. L’atelier se veut ainsi un espace d’échange et de réflexion collective pour partager les savoirs et faire avancer les projets de chacun et chacune. À ces séances, qui seront animées et encadrées par les membres de l’équipe pédagogique, s’ajoutent des conférences générales permettant d’approfondir les connaissances sur certaines questions spécifiques. Les communications peuvent, sans s’y limiter, porter sur les sujets suivants :
La réception des dossiers s’achèvera le 20 octobre 2023 à 13h (heure de Rome).
Membres de l’équipe organisatrice : Céline Béraud, sociologue (EHESS, CéSor) ; Marie Bergström, sociologue (Ined) ; Océane Gudefin Legrand, coordinatrice de l’EUR GSST ; Aïcha Limbada, historienne (École française de Rome) ; Clyde Plumauzille, historienne (CNRS, CMH).
Membres de l’équipe pédagogique : Céline Béraud, sociologue (EHESS, CéSor) ; Marie Bergström, sociologue (Ined) ; Sébastien Chauvin, sociologue (Université de Lausanne) ; Isabelle Clair, sociologue (CNRS, Iris) ; Aïcha Limbada, historienne (École française de Rome) ; Clyde Plumauzille, historienne (CNRS, CMH).
Contact : Océane Gudefin Legrand, oceane.legrand@ehess.fr
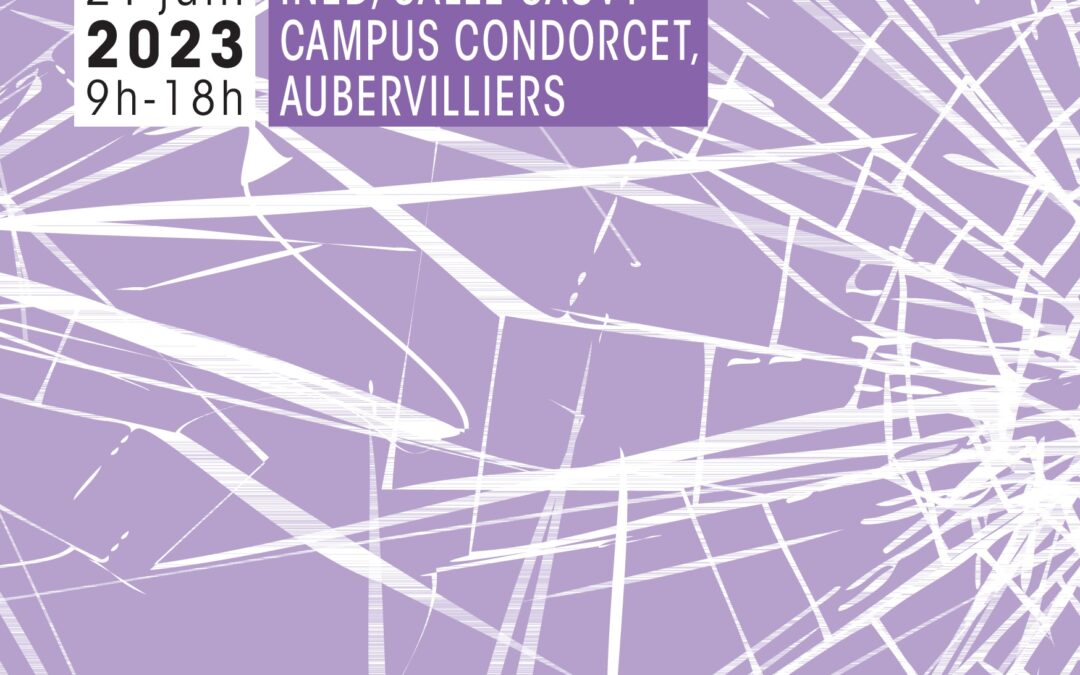
Longtemps à la marge de l’activité judiciaire et presque inexistantes dans les textes législatifs, les violences conjugales sont aujourd’hui un contentieux de masse, qui suscite des stratégies pénales nouvelles et l’investissement de nombreux·ses professionnel·les du droit. Comment punit-on ces violences de genre aujourd’hui ? Quelles sont les normes et les pratiques de jugement à l’œuvre dans cette judiciarisation de l’intimité ? Comment les victimes sont-elles accompagnées dans leurs démarches, comment les auteurs vivent-ils leur peine ? Cette journée d’étude propose une approche sociologique de la prise en charge judiciaire des violences conjugales sous l’angle du genre. Elle présente des recherches sur les dispositifs judiciaires récents, les évolutions de la justice, ainsi que les résultats d’une enquête collective menée depuis 2 ans par des étudiant·es de master de l’EHESS et soutenue par l’EUR GSST.
Mercredi 21 juin, de 9h à 18h
Salle Sauvy, Ined, Campus Condorcet
9h00 • Accueil
9h15 • Introduction
9H30-10H30 • Conférence d’ouverture
Solenne Jouanneau (IEP de Strasbourg), « La justice familiale face aux violences conjugales : de l’invisibilisation à la mise en œuvre d’une protection sous condition »
10H45-12H45 • Panel 1 • Punir : le droit pénal face aux violences intimes
Discutante : Liora Israël (CMH, EHESS)
14H00-16H00 • Panel 2 • Juger : ce qui se joue en audience et en amont
Discutante : Océane Perona (Aix-Marseille Université)
16H30-18H30 • Panel 3 • Accompagner : la prise en charge des victimes et des auteurs
Discutante : Mallaury Bolanos (CMH, ENS-EHESS)
18h30 • Pot, Ined
Mallaury Bolanos (CMH, ENS-EHESS)
Camille Masclet (CESSP, CNRS, Ined)
Adèle Momméja (CESSP, CNRS)
Mathieu Trachman (Ined, IRIS/EHESS)
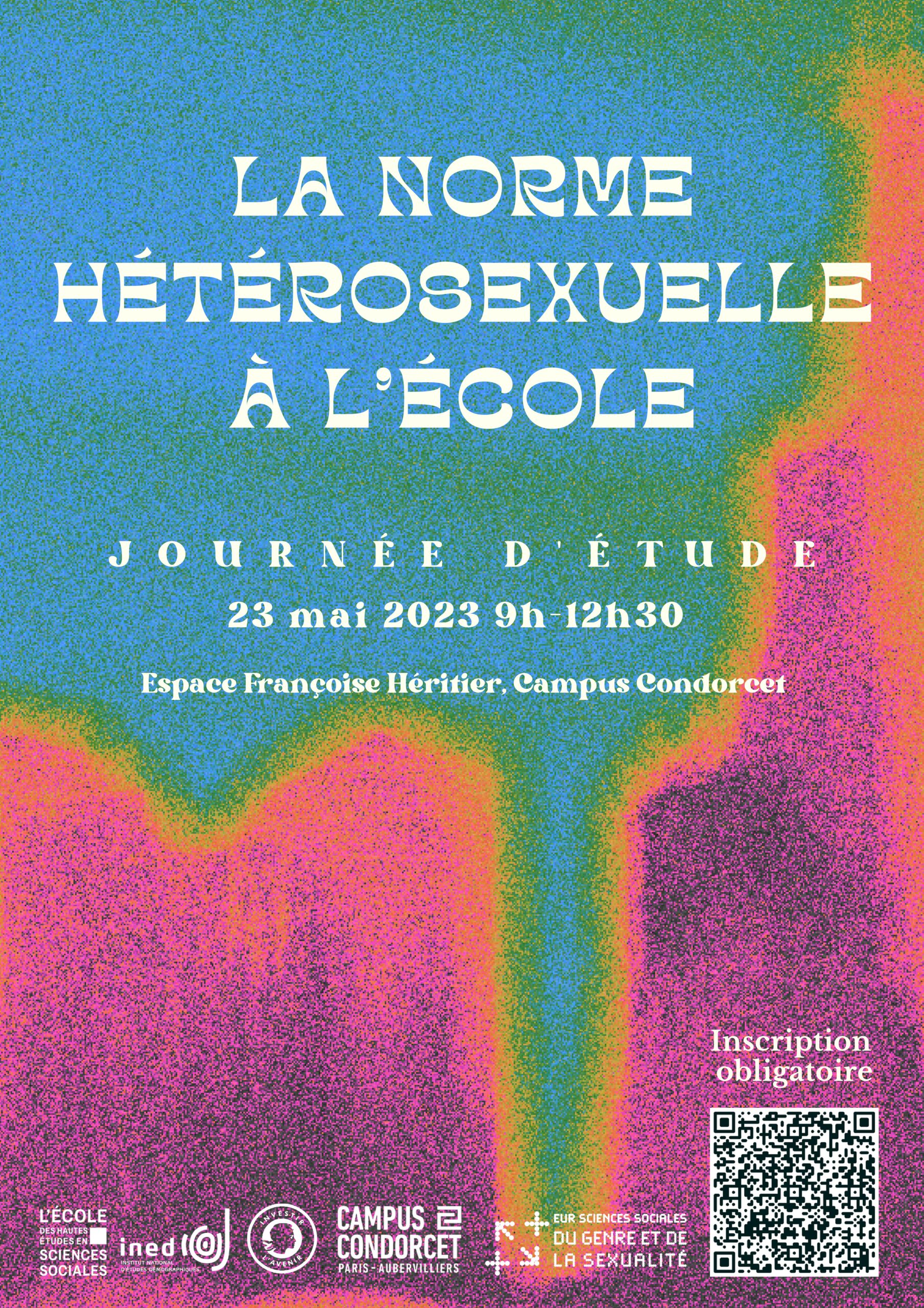
L’EUR GSST soutient la journée d’études « La norme hétérosexuelle » organisée dans le cadre du séminaire « L’institution scolaire face aux rapports sociaux : classe, genre, migration et génération » de Cédric Hugrée (CRESPPA, CNRS).
Mardi 23 mai, de 9h-12h30
Amphithéâtre de l’Espace Françoise Héritier, Humathèque, Campus Condorcet
L’évènement ne sera pas retransmis en distanciel.
Inscription à la journée d’études (obligatoire)
Pour tout contact ou renseignement il est possible d’écrire à lanormeheterosexuellealecole@proton.me.
Programme
9h – Accueil
9h30 – Introduction de la journée
9h45 – Intervention de Gabrielle Richard (LIRTES, OUIEP – UPEC), sur son ouvrage Hétéro, l’école ?, Éditions du Remue Ménage, 2019.
10h35 – Pause
10h50 – Intervention de Kevin Diter (Clersé – ULille) sur ses publications « Aimer d’amour et aimer d’amitié, c’est pas pareil ! », Revue des politiques sociales et familiales, 2020 et « L’évidence de l’hétérosexualité », 2023
11h40 – Discussion transversale
Comité d’organisation
Yona Bernadas
Gaëlle Brasselet
Camille-Lou Coustellié
Clémentine Croisat
Thelma Dourlent
Camille Laugier
Camille Saugon
Matylda Strand