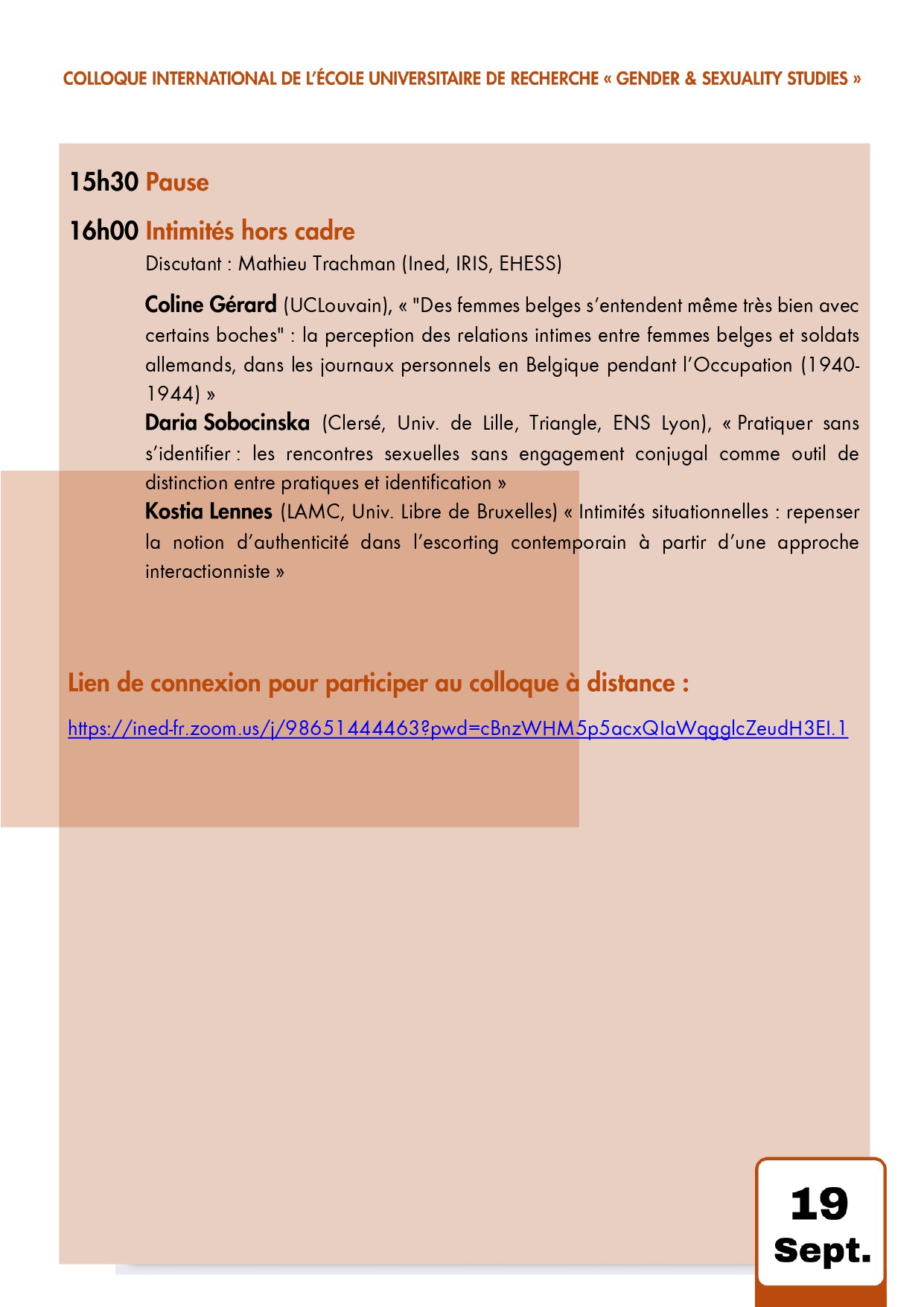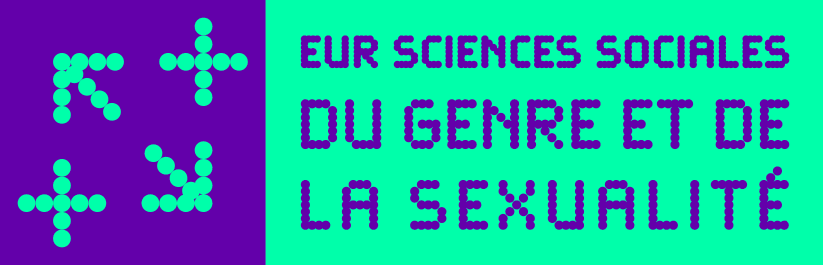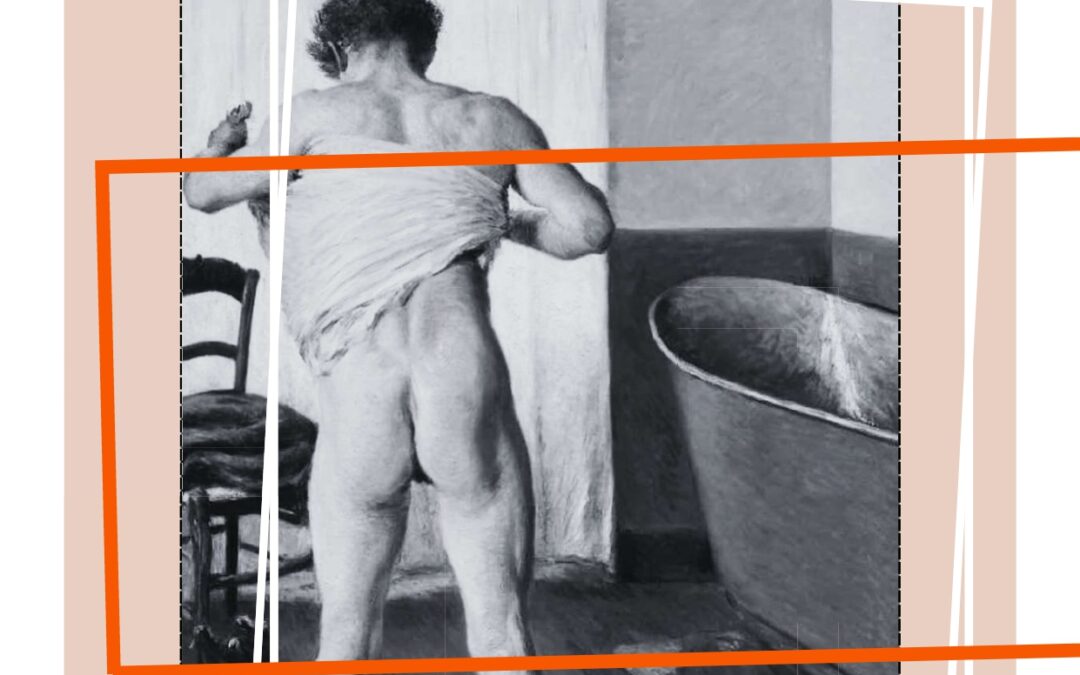Colloque international de l’EUR GSST « Les cadres de l’intimité » – 18-19 septembre 2025
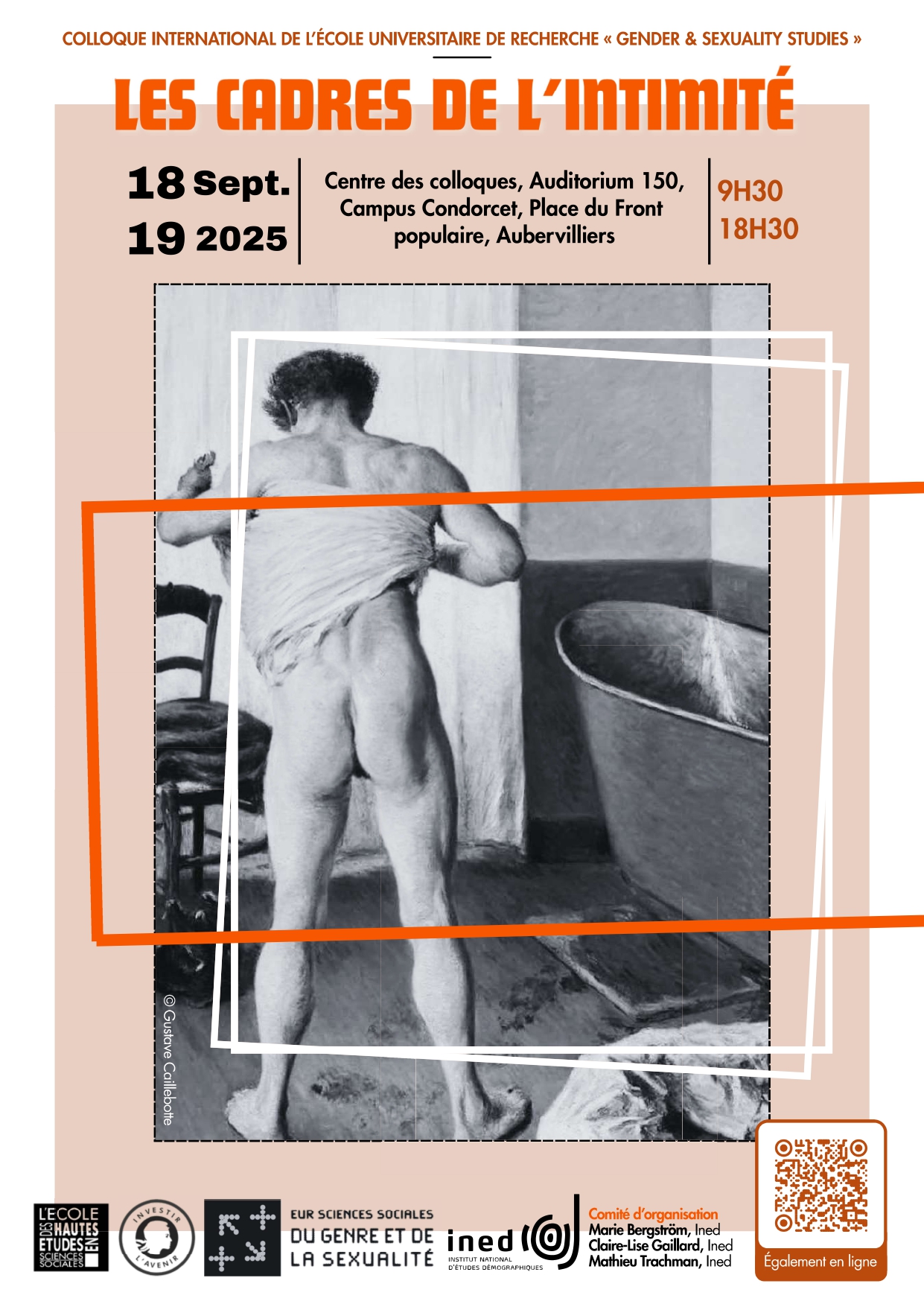
Le colloque Les cadres de l’intimité aura lieu les 18 et 19 septembre 2025, veuillez trouver le programme ci-joint. Organisé par l’EUR Gender and Sexuality Studies (GSST, Ehess-Ined), l’évènement se déroule au Centre des colloques sur le Campus Condorcet et sera également diffusé en ligne : https://ined-fr.zoom.us/j/98651444463?pwd=cBnzWHM5p5acxQIaWqgglcZeudH3EI.1
Marie Bergström, Claire-Lise Gaillard et Mathieu Trachman
Colloque « Les cadres de l’intimité »
La notion d’intimité est aujourd’hui communément utilisée, aussi bien dans les manières dont chacun∙e d’entre nous rend compte de ses relations que dans les espaces médiatiques et académiques. Le nombre de manifestations scientifiques récentes qui abordent la notion est le signe d’une inflexion. Contrairement à la notion de conjugalité, l’intimité englobe des relations faiblement institutionnalisées ; contrairement à la sexualité, elle n’est pas nécessairement érotisée ; elle a une dimension affective, mais n’est pas seulement de l’amour. Elle ne se superpose pas à la notion de vie privée, l’intimité étant au contraire omniprésente dans l’espace public (Berlant, 1997) – les affaires de violences sexuelles en sont un exemple. Cette plasticité de la notion permet de rendre compte des transformations qui ont affecté au cours des dernières décennies les manières de relationner, de faire couple et famille, et plus généralement des liens noués avec celles et ceux à qui nous tenons : le déclin des institutions à principe, la diversification des parcours des individus, la reconnaissance des minorités de genre et de sexualité notamment (Lerch et Stacey, 2011 ; Bozon, 2018). Elle permet également d’inclure des manières de relationner diverses, et moins investies par les sciences sociales : les amitiés, pourtant sans doute centrales dans les sociabilités contemporaines ; les relations éphémères, celles qui ne sont pas conjugales, mais qui ne sont pas non plus des histoires d’un soir (Bergtröm et Maillochon, 2024) ; les liens qui se tissent dans les communautés militantes ou minoritaires – par exemple les relations que la notion de sororité capte aujourd’hui (Ferrarese, 2012).
Ce succès s’accompagne d’une incertitude définitionnelle : la diversification et la désinstitutionnalisation des relations questionnent de fait leurs frontières et leur teneur. Cela a pour conséquence de mettre au premier plan la dimension politique de l’intimité, non seulement dans les inégalités et les rapports de pouvoir qui caractérisent les relations intimes, mais aussi dans les opérations et les institutions qui définissent ce qu’est une relation intime, qui en reconnaissent certaines et en invisibilisent d’autres, qui déterminent les « bonnes » intimités et discréditent les autres. Qui et qu’est-ce qui définit une relation intime ? Quelles sont les diverses manières de relationner et comment sont-elles qualifiées ? Quels sont les enjeux politiques et historiques de cette notion ?