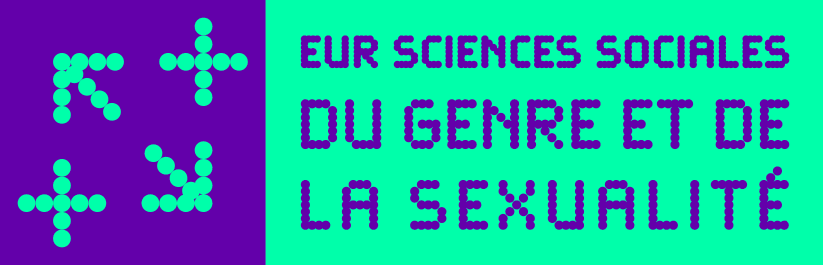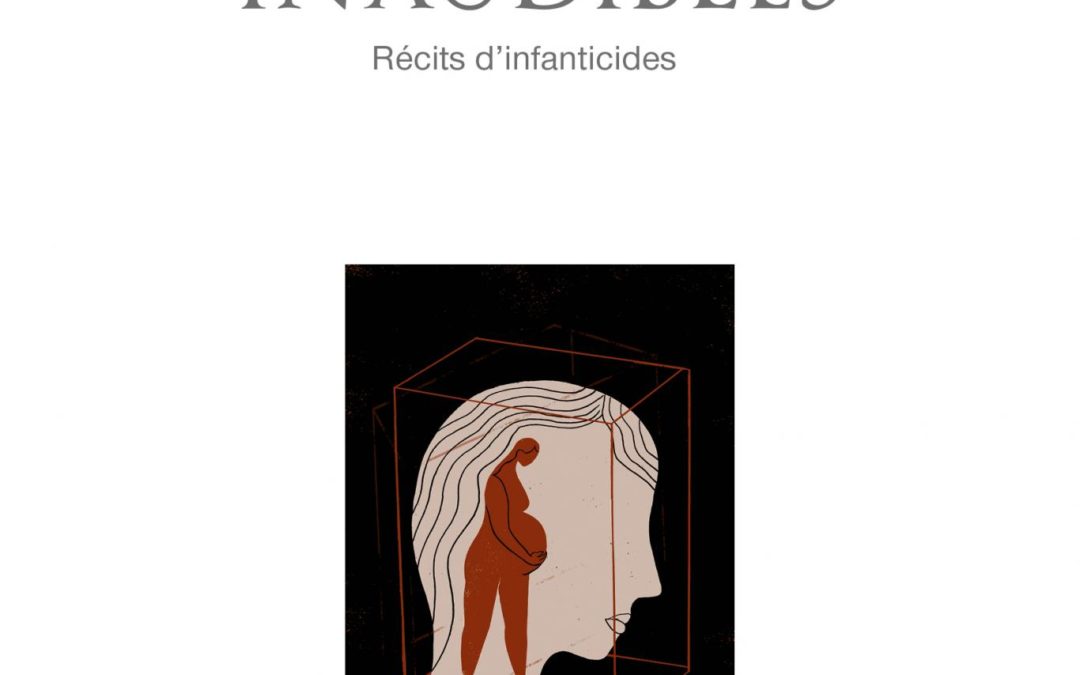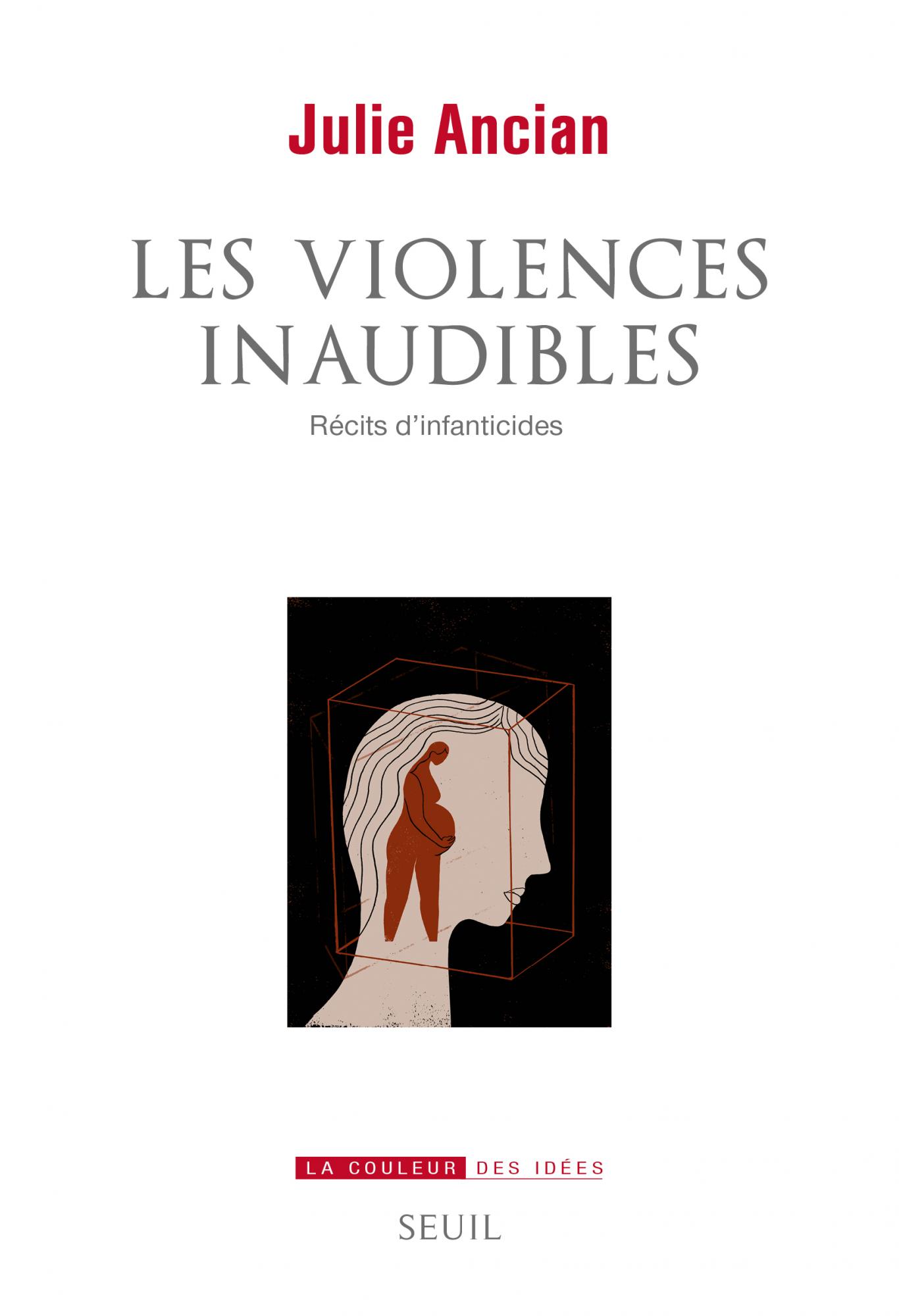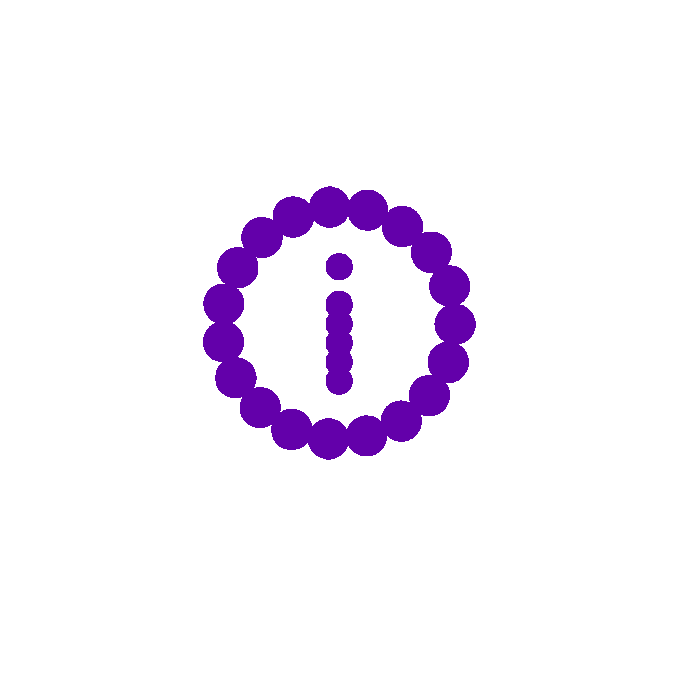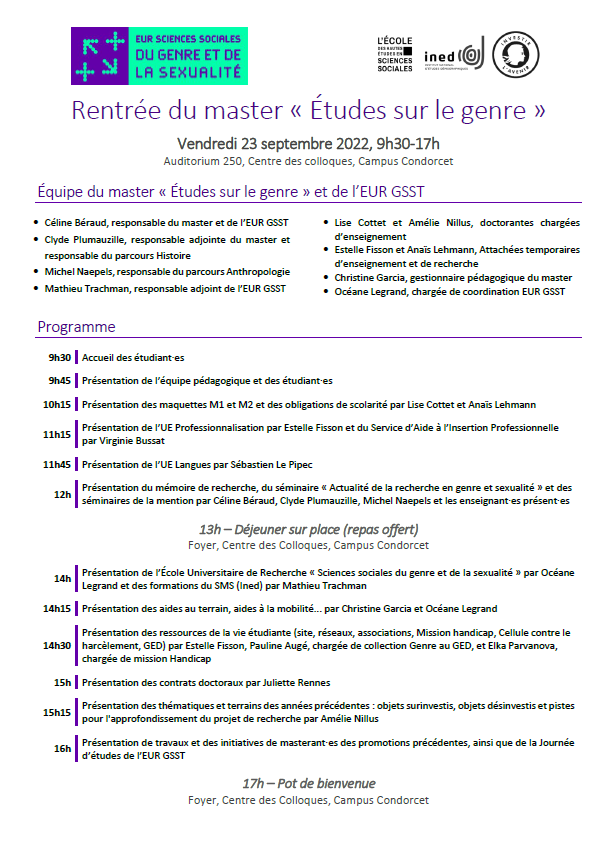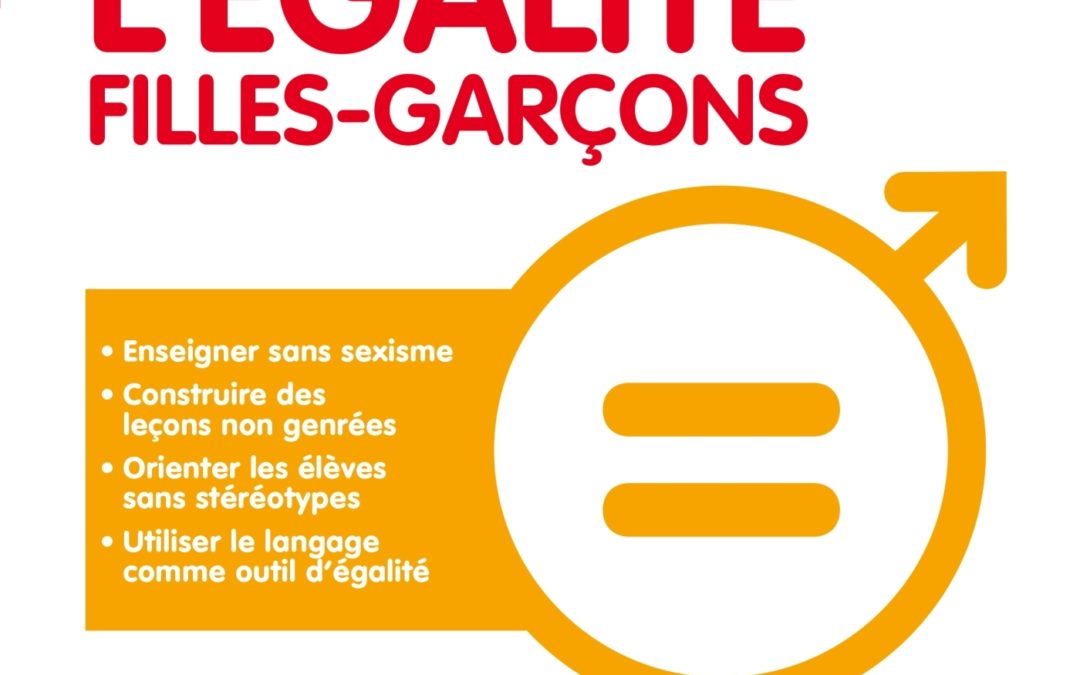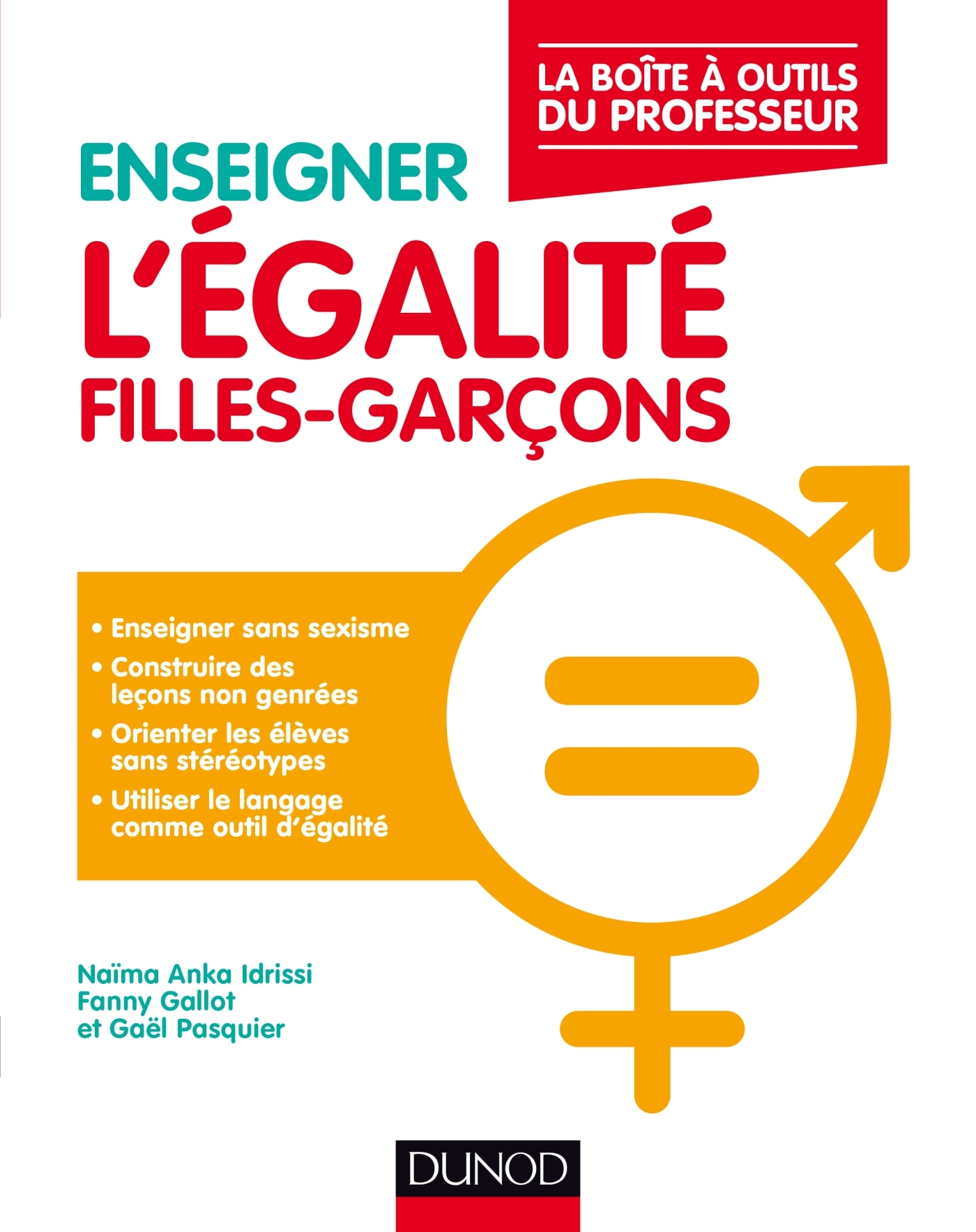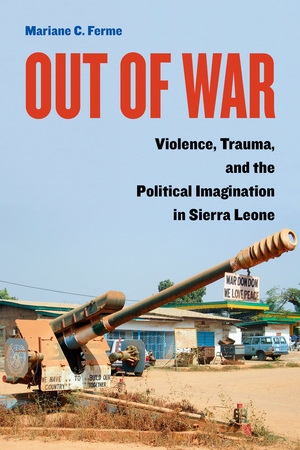Ouverture des candidatures Études en France 2023-2024
Ouverture des candidatures Études en France 2023-2024
Il n’y a qu’une seule et unique session de candidature pour l’entré en M1 et en M2 pour les étudiant·es dépendant de la procédure Études en France. Vous trouverez ci-dessous les consignes à suivre pour compléter votre dossier pédagogique, ainsi que les informations concernant l’Aide à la Mobilité Internationale Entrante proposée par l’EUR GSST.
Les inscriptions et l’ouverture des dossiers de candidature sur la plateforme Études en France a lieu à partir du 1er octobre. La date limite est fixée par l’Ambassade de France de votre pays. En cas de doute entre plusieurs parcours, vous pouvez déposer une candidature par parcours.
Pour candidater au master mention Études sur le genre, votre dossier pédagogique doit comporter un projet de recherche et l’accord d’encadrement signé par un tuteur ou une tutrice de recherche de la mention, en plus de pièces administratives attendues. Ces éléments sont à déposer sur la plateforme Études en France le 15 mars 2023 au plus tard.
- Le projet de recherche :
‐ 2 à 5 pages pour les M1 (bibliographie non comprise),
‐ 7 à 10 pages pour les M2 (bibliographie non comprise).
Le projet de recherche comporte un titre. Le développement doit permettre d’apprécier la connaissance et compréhension de la littérature actuelle du champ de recherche dans lequel s’inscrit le projet de recherche (état de l’art à partir d’une courte bibliographie), la question de recherche envisagée (problématisation), ainsi que le terrain et/ou les matériaux de recherche qui seront mobilisés pour répondre à la question de recherche (terrain/méthodologie d’enquête). Il doit mettre en avant la faisabilité de l’enquête et décrire le matériau sur lequel celle-ci va (archives et/ou des entretiens et/ou des données quantitatives et/ou un corpus textuel, audiovisuel et/ou des observations ethnographiques…). - Vous devez obligatoirement avoir trouvé une personne (tuteur ou tutrice de la mention) pour encadrer votre recherche. Cette personne doit remplir et signer l’accord d’encadrement à déposer sur Études en France le 15 mars 2023 au plus tard.
Conseil dans les démarches : Il convient d’identifier un tuteur ou une tutrice spécialiste du champ de recherche dans lequel s’inscrit le projet de recherche proposé et de le ou la contacter en présentant votre projet de recherche et en joignant votre CV. La liste des tuteurs et tutrices est téléchargeable sur la page du site du master. Vous pouvez également utiliser le moteur de recherche par thématique du site de l’EUR.
L’EUR GSST a mis en place une Aide à la Mobilité Internationale Entrante (règlement de l’aide à lire). Chaque année, un·e étudiant·e international·e ayant obtenu son diplôme le plus récent à l’étranger peut bénéficier de cette aide d’un montant de 10 000€ sur 2 ans (5 000€ pour la première année de master, 5 000€ pour la deuxième année). Le règlement détaillé de la bourse est disponible ici. Pour y candidater, il est nécessaire d’envoyer le formulaire de candidature complété par mail à gestion.eurgsst@ehess.fr le 15 mars 2023 au plus tard.
Plus d’informations concernant la candidature sont disponibles sur la FAQ,
en particulier les points « Candidat·es internationaux·ales » et « Projet de recherche et tuteur·ice »
Contact : orientation.genre@ehess.fr